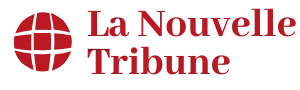Le vocabulaire technique et critique de la philosophie de André LALANDE définit d’une façon générale la liberté comme « l’Etat de l’être qui ne subit pas de contrainte, qui agit conformément à sa volonté, à sa nature », ou encore « l’Etat de celui qui fait ce qu’il veut et non ce que veut un autre que lui ; elle est l’absence de contrainte étrangère » La liberté de pensée et la liberté d’expression sont, dans le domaine social, des applications particulières du sens général donné par LALANDE.
Elles font partie des libertés publiques. Les conditions de jouissance de toutes ces libertés sont juridiquement définies afin de permettre à chaque individu d’agir sans contrainte et d’être protégé contre l’ingérence de l’Etat et des autres membres de la société. Pour parler comme les juristes, ce sont des pouvoirs d’autodétermination consacrés par le droit positif.
La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, en rigueur de terme, reconnaît à l’individu le pouvoir d’agir sans contrainte, de former, de combiner des idées et des jugements, de tenir pour vraies une assertion, une conviction, une croyance, et de les exprimer comme bon lui semble, sans toutefois enfreindre la loi. Il s’agit de la liberté de pensée et de la liberté d’expression, respectivement objet des articles 18 et 19 du grand texte historique adopté par l’Assemblée générale le 10 Décembre 1948. L’article 18 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Août 1789, envisageait la liberté de conscience de la manière suivante : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». La déclaration de 1948, en son article 18 aussi, procède au contraire de façon affirmative : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun tant en public qu’en privé ». On note la même quintescence dans les deux déclarations malgré la différence de formulation. Il est question de la non ingérence dans l’activité spirituelle et intellectuelle de l’individu, du respect de sa vision du monde et des choses. Ce droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est d’importance, en ce sens qu’il fait partie des droits indérogeables en toute circonstance, même dans un état d’exception. Il permet à l’individu d’apprécier par rapport au bien et au mal tout ce qui affecte la conscience morale, d’entrer en relation avec un être suprême qu’on appelle du nom qu’on veut. La pensée donne à l’homme une valeur particulière qui le distingue remarquablement des autres créatures à tel point que le mathématicien et philosophe français Blaise Pascal a affirmé sans ambiguïté que « la grandeur de l’homme réside en la pensée ». Par ailleurs Descartes n’a pas hésité à dire que le fait même de penser traduit celui d’être : « je pense donc je suis ». Il convient aussi d’aborder le phénomène suivant, de façon lapidaire. Le monde n’étant pas statique, mais plutôt dynamique, évoluant donc selon la dialectique hégélienne, loi du développement du réel et du rationnel, et l’homme, subissant l’influence de son milieu, puis étant également « un être ondoyant et divers » pour parler comme Montaigne, il est évident que l’individu change à plus d’un égard. C’est regrettable que ce changement dans le domaine religieux ne soit pas permis dans certaines régions. C’est cette liberté de changer de religion qui a motivé l’abstention de l’Arabie Saoudite lors du vote en 1948 de la déclaration universelle des droits de l’homme. Chacun a besoin d’exprimer librement sa pensée, son opinion, ses sentiments. A cet effet, l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme dispose : « toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression ; ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ». En outre, la déclaration de 1948, considère « qu’un monde où l’on est libéré de la peur et de la misère, où l’on est libre de croire et de parler constitue la plus haute aspiration de l’homme ».
La différence
La liberté de pensée de conscience et de religion, ainsi que la liberté d’expression relèvent respectivement des libertés de la personne et des libertés de communication. Ce sont là certaines composantes des libertés publiques, fondamentales dans les démocraties occidentales, inexistantes dans les démocraties populaires. Pourquoi cette différence ? C’est que dans les démocraties occidentales, il existe ce que l’on appelle l’Etat de droit dans toute l’acception du terme, un concept qui remonte bien loin dans le temps, et qui a subi des mutations substantielles au cours des siècles. Si l’on en croit l’histoire, ce concept est apparu en Europe, notamment dans la partie continentale vers 500 AD. Mais curieusement, c’est en Angleterre, mère des démocraties modernes, qu’il a pris une conmotation résolue après la conquête normande en 1066, période au cours de laquelle, Guillaume le conquérant a institué une administration centrale, et suprême, sous-tendue par le respect rigoureux de la loi ; d’où l’expression « the rule of law » Même le Monarque n’était en aucun cas en mesure de s’autoriser de son pouvoir pour se mettre au-dessus de la loi, étant lui-même le produit de celle-ci, du fait que son accession au trône, ne se faisait pas anarchiquement, « qui alex facit regem ». En définissant ce concept sèchement, on dira qu’il désigne « un Etat dans lequel les organes administratifs et juridictionnels se trouvent liés par les règles générales et impersonnelles, c’est-à-dire au sens matériel par la loi. Mais avec le temps, il a subi dans le pays de sa grâcieuse majesté ElizaBeth II, des mutations sous l’impulsion du système parlementaire, du besoin de libertés publiques, de la nécessité d’une justice efficace, de l’équité et du bien être du peuple. Il va sans dire que cette évolution n’est pas sans impact sur les autres démocraties occidentales. Les pays africains comme le Bénin, le Mali, le Sénégal, le Ghana, pour ne citer que ces quatre, sont devenus tributaires de cette évolution, bien des décennies après. Sans un Etat de droit approprié, celui où l’individu est pris en compte dans toutes ses dimensions, il n’y a pas de liberté de pensée, ni de liberté d’expression, ni les autres libertés publiques. Les libertés de pensée et d’expression pour ne citer que ces deux pour le moment, par lesquelles l’individu se définit, précise son identité, et s’affirme face au monde et aux choses font partie des piliers d’une vraie démocratie et témoignent de la réalité de l’Etat de droit . Il convient de signaler que la liberté d’expression est dérogeable provisoirement, même dans un Etat de droit en cas d’Etat d’urgence ou de siège, pour être rétablie dès le retour à la normale ; ce qui ne saurait être le cas comme déjà indiqué, pour la liberté de pensée, de conscience et de religion qui constitue une garantie fondamentale intangible.
Le cas Nicaise Fagnon
Les citoyens peuvent exprimer leurs opinions partout, tant qu’il n’y a pas d’Etat d’urgence ou de siège. C’est le lieu de rappeler que les propos tenus à Dassa il y a quelques semaines par un ministre de la République, portent gravement atteinte au droit de parler d’un homme politique de son choix, où l’on veut et comme l’on veut. Le non respect de ce principe démocratique et républicain a fait craindre le retour à un ordre déjà vomi par le peuple. La déclaration interpellative formulée par une bonne quinzaine de députés, suite à cet incident malheureux, a été jugée recevable par l’Assemblée nationale au nom du peuple épris de liberté. Il est à expérer que le chef de l’Etat, garant de la constitution, de l’ordre et de la loi, prendra la mesure de la réaction des parlementaires pour que le régime républicain et démocratique ne soit pas compromis.Il convient de reconnaître qu’au Bénin, la liberté de pensée, de croyance et de religion est pleinement respectée.
C’est normal que la liberté d’expression mérite le même respect. Chaque citoyen a le droit d’en jouir, tout en se persuadant que les autres ont ce même droit. D’où la nécessité de faire en sorte que les membres de la communauté nationale, toutes catégories confondues, comprennent que les droits de l’homme et les libertés publiques, appartiennent à chacun et à tous . On évitera ainsi les frustrations, source de tension préjudiciable à l’harmonie nationale. Car, nous avons besoin de construire notre pays dans la paix et la sérénité.
Par Jean-Baptiste Gnonhoué
Président de la coalition béninoise pour la Cour
Pénale Internationale