Depuis février 2022, l’Ukraine est le théâtre d’un conflit armé de grande ampleur, marqué par des combats intenses, des destructions massives et une profonde instabilité régionale. Lancée par la Russie dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, l’offensive a rapidement pris une dimension stratégique, politique et humanitaire majeure. Malgré de nombreux efforts diplomatiques, la guerre perdure, redessinant les équilibres internationaux. Le pouvoir russe affirme régulièrement sa volonté de préserver ses intérêts de sécurité, tandis que les initiatives de médiation, notamment par les États-Unis, peinent à produire des avancées durables.
Le Kremlin a annoncé ce vendredi la fin du moratoire temporaire imposé sur les frappes visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Cette mesure, initialement décidée le 18 mars dernier par le président Vladimir Poutine, consistait en une suspension de trente jours des attaques contre ces cibles spécifiques. Elle faisait suite à un échange téléphonique avec le président américain Donald Trump, dans un climat diplomatique tendu mais ouvert à des gestes de désescalade.
L’arrêt des frappes avait été salué comme un signe de détente, bien que contesté de part et d’autre. En effet, dès les premiers jours du moratoire, des accusations mutuelles de violations ont été formulées par Moscou et Kiev. Chacune des deux capitales dénonçait des atteintes aux engagements pris, remettant en question la portée réelle de cette trêve partielle. Ce flou persistant a alimenté les doutes quant à la sincérité des intentions, tant sur la durée du cessez-le-feu que sur ses modalités d’application.
À ce jour, aucune instruction nouvelle n’a été communiquée par le commandement russe pour prolonger ou reconduire cette suspension, a précisé Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence, lors d’un point de presse. Tout en réaffirmant que Moscou restait disposée à engager un dialogue pour une issue négociée au conflit, le porte-parole a souligné la priorité donnée par la Russie à la défense de ses intérêts fondamentaux.
La tentative d’instaurer un accord triangulaire entre Washington, Moscou et Kiev sur les frappes ciblées avait pourtant été présentée par les autorités américaines comme un pas dans la bonne direction. L’Ukraine avait exprimé un accord de principe à une trêve globale, mais cette proposition, portée par Donald Trump, n’a pas été retenue par le Kremlin, préférant une approche plus sectorielle du conflit.
Alors que les affrontements se poursuivent et que la situation humanitaire reste critique, l’expiration du moratoire pourrait annoncer une reprise des hostilités contre les infrastructures énergétiques, stratégiques pour la résilience ukrainienne. Cette évolution pourrait compliquer davantage les efforts de médiation et renforcer les tensions sur le terrain.
La fin de ce moratoire soulève donc des interrogations sur les intentions futures de Moscou. S’agit-il d’un simple retour à l’état antérieur ou d’un tournant stratégique dans la conduite des opérations ? Si la Russie réaffirme son ouverture au dialogue, elle insiste également sur la nécessité de défendre ses priorités géopolitiques. Une posture ambivalente, qui entretient l’incertitude sur la suite du conflit.
Alors que les infrastructures énergétiques ukrainiennes sont des cibles clés pour affaiblir la résilience du pays, leur protection reste un enjeu vital pour Kiev. L’expiration du moratoire pourrait ainsi marquer un regain de vulnérabilité, à un moment où les populations civiles et les autorités locales espèrent un retour progressif à une forme de stabilité.
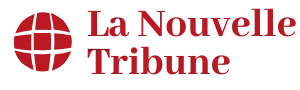


Les trolls, soutiens du néo-impérialiste Poutine sont de sortie.
Arguments merd… injures, diarrhées verb… – scripturales plutôt.
tantôt faisant passer les dires des sbires de Poutine pour parole d’évangile, tantôt s’appuyant sur les dires vrais ou supposés de tel officier ukrainiens, journal occidental, ou pique-assiette médiatique (j’adore),
Bref le seul intérêt est de montrer et de dire à quel point la réalité est éloignée des désirs de grande Russie tsariste, du chef de gang, pillard de l’économie russe et dictateur démontré
\\\\.///
(@_@)
Ouais … tant que tu y es, tu pourrais aussi annoncer la défaite de la Russie pour Pâques, histoire de célébrer la fête des cloches en grandes pompes !
C’est pas toi qui prétendais que les ukros avaient la maîtrise du ciel ?
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Ah ben non ! Z’ont fait une trêve en l’honneur des cloches de ce forum, probable !
« à quel point la réalité est éloignée des désirs de grande Russie tsariste »
Le propre des imbéciles, c’est de prêter aux autres ses propres fantasmes
« Russie tsariste »
On peut peut-être rappeler qu’à cette époque tes parents en étaient encore à bouffer du missionnaire 😉
« Ukraine : la Russie annonce la fin d’un moratoire, et après ? »
Comme les ukros n’ont pas respecté le moratoire, histoire de torpiller Trump et sa volonté de faire la paix, il semblerait logique que dès demain les Ruskoffs défoncent toutes les infrastrutures énergétiques ukronazes.
N’en déplaise à Ursula la hyène et autres tarés style @¦@, c’est pas les missiles qui manquent.
Les ducons russes sont de passage par ici.
Salut
Luc Fery n’a rien dit du tout à ce sujet. Quant à NY Times, c’est tes con ne ries comme d’hab.
Les pro-ukraine dans le déni à don’f ! 🤣 🤣 🤣
Les prochianes semaines vont être grandioses 🤣
Va dans le Sahara, t’auras assez de sable pour y fourrer ta tronche de débile!
Pour les moins c.o.n.s, Luc Ferry sur youtube : « Je pense que c’est l’Ukraine qui a déclenché cette guerre »
youtube watch?v=Ks3MqMqdKLo
Parce que Luc Fery pique assiettes à LCI est une référence pour toi. Très bien.
C’est vrai tu es une lumière ici avec tes emojis d’abruti.
Suffit pas de savoir lire, faut encore comprendre ce que tu lis !
Je vais te traduire en débilos : « Même ce crétin de Ferry sur LCI reconnait que c’est l’Ukraine qui a provoqué cette guerre ! »
Valà, je peux pas descendre plus bas, sinon que te filer 10 balles pour aller t’acheter du foin pour ton repas pascal !
Faut en finir avec cette pantalonade. Même sur LCI, ça commnce à tourner sa veste : LE Luc FERRY reconnait que la fable de « l’Ukraine agressée » est une grosse blague montée par les USA qui ont reconnu être à l’origine du conflit et manipuler les ukros depuis l’Allemagne
Source : NewYork Times
Depuis 150 ans TOUTES les guerres ont été déclenchées par des mensonges, des provocations et des false flags, la plus connue étant la guerre de 2003 en Irak.
La guerre en Ukraine a été provoquée par les Ukrainiens qui ont intensifié, à la demande des USA, leurs frappes sur le Donbass, sachant que cela obligerait Putin à intervenir. Auparavant, toutes les rédactions occidentales avaient reçu le texte à réciter et prêtes à hurler à l’agression « non provoquée ». Elles ont toutes utilisé le même discours, à la virgule près.
Et les moudus ont tout gobé …
Faut en finir avec cette pantalonade. L’Ukraine a perdu. Plus ça dure, plus elle perd de plumes et plus les condition des Russe seront dures.
Perso, j’espère qu’ils vont continuer et prendre Odessa. Ses habitants n’attendent que ça ! Poutine va se faire traiter de puant s’il les laissent à la merci des ukro-anglo-français qui la veulent absolument.