Le siège du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou (Fespaco) abrite depuis 1995, la cinémathèque africaine de Ouagadougou qui travaille pour la sauvegarde du patrimoine cinématographique africain.
Avant d’être depuis 2014 Délégué général du Fespaco, Ardiouma Soma a été longtemps responsable de ce centre d’archivage du cinéma et de l’audiovisuel africain. Il nous parle ici de l’historique de cette cinémathèque et de l’état de ces archives mais également du secret de la longévité du Fespaco, l’institution qui abrite le centre.
Vous avez été longtemps responsable de la cinémathèque africaine de Ouadadougou. Quelle est l’histoire de ce centre ?
Au départ, il y avait une cinémathèque au Burkina Faso depuis les années de l’indépendance en 1960 parce qu’au Burkina Faso à l’instar de plusieurs pays africains, le cinéma a été utilisé pour communiquer avec les populations certainement à cause des diversités linguistiques. Il y a beaucoup de films qui ont été faits à l’époque, les films d’éducation sur la santé, etc. Avec le cinéma mobile, les films étaient diffusés dans l’ensemble des pays. Donc cette cinémathèque existait et elle a été transférée au Fespaco à partir des années 1980. Le Burkina Faso a abrité le siège de la Fédération panafricaine des cinéastes après le congrès de 1985 qui s’est déroulé à Ouagadougou avec le Président Thomas Sankara qui a décidé de prendre en charge la Fepaci. C’est avec la Fepaci que le Fespaco a décidé en 1989 de lancer la cinémathèque africaine. La Fepaci a permis d’obtenir l’autorisation des cinéastes africains pour obtenir les copies des films. C’est comme ça que cette archive à commencer avec l’inauguration du centre de conservation en 1995. Avec le peu de moyen qu’on a, on a réussi à construire ce centre et on met l’accent sur la collecte.
Quel est le contenu aujourd’hui ?
Aujourd’hui, on a une filmographie assez importante sur le continent africain ; on a plus de 5000 titres de films. Malheureusement il n’existe pas encore de catalogue avec l’ensemble de ces différents films. Le Fespaco est une base importante de collecte du patrimoine filmique africain à cause du simple fai que tous les deux ans, c’est des centaines de films africains qui sont inscrits et constituent un patrimoine assez important.
Est-ce que ce patrimoine est accessible au public ?
Il ne l’est pas pour le grand public. Pour qu’il soit accessible au grand public il faut tout un travail de dépouillement, de traitement, de numérisation. Cela n’est pas possible pour le moment. Mais il y a un accès aux professionnels que vous êtes- les journalistes-. Ceux qui viennent vers nous arrivent à trouver satisfaction. Au-delà des films il y a tous ces éléments non film qui passent au Fespaco autour du cinéma africain, que ça soit les actes des colloques, les coupures de presses, les revues, il y a une documentation assez importante. Là aussi ce n’est pas ouvert au grand public mais les consultations organisées sont possibles et nous sommes disposés à accueillir ceux qui ont des besoins particuliers d’avoir accès à ces archives.
Comment ces archives sont-elles entretenues ?
Ces archives, j’avoue, ne sont pas bien organisées pour le moment parce qu’il y a un besoin financier pour pouvoir déployer tout ce patrimoine et le mettre en valeur. On a collecté mais la difficulté c’est dans la mise en valeur de ce patrimoine. La mise en valeur c’est important. Il ne sert à rien d’accumuler sans pouvoir mettre à la disposition du public. On fait ce qu’on peut avec le peu de moyen qu’on a. Peut-être, d’autres viendront après pour faire le travail de dépouillement, élaborer des catalogues, numériser, etc. La question revient de plus en plus. Elle a fait récemment question de discussions au dernier festival de Carthage parce que effectivement, l’Afrique, notre continent a un très riche patrimoine cinématographique et audiovisuel qui ne va pas seulement de la période où les africains se sont mis derrière les caméras pour se filmer. Mais ça date du début du cinéma en 1895 parce que l ’Afrique a été énormément filmée à plusieurs étapes. L’Afrique a été d’abord filmée par les ethnologues, les chercheurs qui considéraient l’Afrique comme un terrain d’expérimentation. L’Afrique a été ensuite filmée par les religieux, ceux qui nous amenaient la bonne nouvelle. L’Afrique a été filmée par le colon pour justifier la politique coloniale en occident pour pouvoir obtenir les financements pour pouvoir développer cette politique de la colonisation ; et pendant les deux guerres, l’Afrique a été filmée. Et même au niveau du cinéma commercial, l’Afrique existe dans le patrimoine parce que le continent a servi de décor aux grands studios de production en Angleterre et en Amérique dans les années 40. Moi-même, il y a un film français qui a été tourné dans mon village en 1949. Heureusement j’ai retrouvé les archives françaises. Et comme disait Sembène, ces images sont très peu vues. Ceux qui sont en charge des archives aujourd’hui en Europe ne programment jamais ces archives parce qu’ils ont eux même honte de ces archives. La façon dont l’Afrique était montrée avec les commentaires, ce n’est pas leur position aujourd’hui, mais nous ça nous intéresse. On a besoin de ces archives pour nous connaitre ; connaitre notre passé, mieux découvrir notre présent et mieux préparer notre futur. Heureusement, les archives là existent et en bon état parce les archivistes en occident les ont réhabilitées. Maintenant, il faut arriver à établir des collaborations avec les archives occidentales pour ne pas parler de rapatriement mais que l’Afrique puisse avoir accès à ce patrimoine.
Vous êtes depuis 2014, à la tête de l’institution qui abrite ce centre d’archivage. C’est le Fespaco qui a déjà 47 ans . Quel est le secret de cette longévité ?
En 47 ans, le Fespaco s’est tenu de façon continue. Pour l’histoire, le festival a commencé en 1969. C’était à partir d’une initiative privée de cinéphiles qui assistaient aux séances de projection de films au Centre culturel français à l’époque. C’est à partir de ce stock là que les cinéphiles burkinabè ont décidé sur la base d’une association d’organiser ce qu’ils appellent à l’époque la quinzaine du cinéma africain. Ils l’ont fait en 1969. En 1970, ils l’ont réitéré et cela a pris tellement d’ampleur avec l’engouement du public qui pouvait enfin voir ces films hors des murs du centre culturel français. C’était dans les quartiers de la ville de Ouagadougou. A partir de 1972, le festival a été institutionnalisé par l’Etat. Ce n’est pas un fait du hasard. Les plus anciens vous diront que la fin des années 1960 correspondait à une période de révolution intellectuelle en Afrique au niveau de la littérature, des arts et de la culture. On se souvient du festival des arts nègres en 1966 et on se souvient aussi de toute la politique de soutien des pays en lutte pour la décolonisation avec l’Algérie en tête qui a aussi organisé le festival panafricain en 1969. On se souvient que dans cette mouvance aussi, nos écrans étaient dominés par les consortiums européens et le Burkina Faso a décidé en 1970 de nationaliser la distribution et l’exploitation cinématographique. Cette décision a été applaudie par les cinéastes africains, avec Sembème Ousmane en tête qui a réuni les cinéastes pour réagir face au boycott des consortiums qui avaient décidé de boycotter le Burkina Faso. Ils –les cinéastes ndlr- ont pris l’avion pour venir remettre leur copie de films au Chef de l’Etat pour que la distribution et l’exploitation continuent au Burkina. Tout ça a contribué en 1972 à amener l’Etat à décider donc de proposer à Sembène et ses cadres, d’institutionnaliser ce festival. En institutionnalisant, c’est comme si ce pays prenait un engagement vis-à-vis des pays africains qui sont venus le soutenir dans sa politique de nationalisation. Le Burkina a dit «à partir de ce moment, ce festival, je le soutiens ; je crée et je finance pour vous un espace de promotion de votre activité.» Tous les gouvernements successifs du Burkina Faso ont tenu cet engagement. Je pense aussi que les cinéastes africains expriment leur reconnaissance à ce pays pour cet effort qui est fait quand on voit leur engouement autour de ce festival. Ils ne négocient pas leur participation au Fespaco. Peut-être que la longévité vient aussi du fait qu’il y a l’Etat qui se trouve derrière ce festival parce que nous sommes des fonctionnaires de l’Etat et il y a un contrôle permanent au quotidien de nos activités. Le Délégué général que je suis ne peut pas dépenser un franc sans que ça ne passe au contrôle financier du ministère des finances, etc. Cela constitue une garantie importante vis-à-vis des partenaires qui apportent les différents financements. Il y a un engagement politique assez fort de ce pays pour que ce festival soit pérenne et aussi l’engagement tout simplement des cinéphiles.
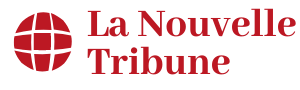
Laisser un commentaire