Les entreprises publiques béninoises relèvent, pour la plupart, de secteurs stratégiques tels que l’énergie, les télécommunications ou les transports, ce qui leur confère une position monopolistique sur leurs marchés respectifs. Elles sont, par conséquent, à l’abri de rivalités concurrentielles qui pourraient les conduire à garder confidentielles certaines données managériales, sociales, économiques et financières.
Mais paradoxalement, la communication auprès du grand public et à plus forte raison auprès de leur propre personnel relative à l’évolution de l’entreprise (progression du chiffre d’affaires et du nombre de salariés, évolution des bénéfices…) est quasi inexistante.
Peut-on l’imputer aux reliquats de la féodalité, au syncrétisme prégnant, ou alors au côté réfractaire des dirigeants à la reddition des comptes ?
Les propos d’un important partenaire social du Bénin illustrent bien cette opacité : « les mentalités et les pesanteurs sociologiques du Bénin ne permettent pas de recueillir aisément les informations au sujet des formations, expériences, diplômes, rémunérations annuelles des directeurs des entreprises d’Etat (sociétés publiques et semi-publiques) et des chiffres d’affaires des ces entreprises, y compris le nombre de salariés. L’omerta sur ces informations est consternante et mérite d’être dénoncée ».
Les entreprises publiques étant la propriété de tous les citoyens béninois, il paraît surprenant que la vie de celles-ci soit sous le sceau du secret et renforce ainsi la suspicion qui prévaut dans les affaires de corruption défrayant la chronique.
Cet état de choses transpire, semble-t-il, la confiscation par certains de la chose publique. Dans ces conditions, comment défendre efficacement et prendre à témoin les citoyens, lors de la promotion d’un projet stratégique profitable à l’ensemble de la société ?
Au nom de l’intérêt supérieur de la nation, il est, aujourd’hui, indispensable que la lumière portée par la transparence puisse éclairer les rouages de la vie de l’entreprise publique, et devienne le « meilleur désinfectant » au sein même de celle-ci, comme vis –à-vis de l’extérieur.
Au sein de l’entreprise
S’agissant du système de gouvernance, les dirigeants doivent être capables de mettre en place des modèles et outils, des méthodes de management permettant d’asseoir durablement la rentabilité de l’entreprise publique. Afin d’y parvenir, ils doivent exercer une communication prompte et didactique à l’endroit du personnel, sur tous les éléments fondamentaux touchant au social, à l’économique et au financier. En instillant ainsi les informations sur les activités de l’entreprise, les salariés pourront facilement être mobilisés pour accompagner avec adhésion et appropriation la déclinaison des nouveaux projets.
Ils devront aussi mettre en place des protocoles clairs dans le respect strict des lois et règlements, en ce qui concerne, par exemple :
– les achats ordinaires et les marchés publics (le personnel doit être informé de la procédure et de sa mise en œuvre et pouvoir éventuellement s’y prononcer ;
– les recrutements qui doivent faire l’objet d’annonces publiques claires et précises, et dont l’inobservation peut entraîner, de la part de ceux qui ont intérêt à agir, un arrêt du processus.
A la part fixe du salaire du dirigeant, il faudrait prévoir une part variable répondant à des critères de performance sociale, économique, financière et environnementale. Faire en sorte également que le total du salaire du directeur général ne dépasse pas 25 fois celui du bas salaire moyen.
Un contrôle interne, exercé par les auditeurs internes (avec un statut spécial d’autonomie) et réalisé dans de bonnes conditions, permet d’ajuster la volatilité du cash flow et, au management, d’orienter judicieusement les décisions importantes pour la durabilité des activités de l’entreprise.
Cette liberté d’action des contrôleurs internes, à l’image des comptables publics, constituerait un contre-pouvoir efficace. C’est ainsi qu’ils cesseront d’être des « imprécateurs dans le désert » et retrouveront leur véritable rôle de conseiller et de déclencheur d’alerte auprès de la direction générale et du conseil d’administration. La prise en compte systématique des réserves émises par les commissaires aux comptes pourrait être l’autre volet de ce contre-pouvoir.
Un autre contre-pouvoir est celui pouvant être constitué par les lanceurs d’alerte, avec un statut protecteur pour les salariés qui dénoncent des actes illicites. Ils bénéficient ainsi d’une « immunité vis-à-vis de leur employeur, mais à condition d’être de bonne foi.
Un troisième contre-pouvoir qui confèrerait aux syndicats internes (tout en intégrant les risques d’accointance avec les dirigeants) un droit de veto en cas d’agissements contraires à l’intérêt supérieur de l’entreprise (marchés truqués, embauches népotiques, sorties d’argent ou de biens frauduleuses etc.…)
La visibilité à l’égard des autres acteurs
L’Etat doit mettre en place une procédure clairement définie et transparente pour la nomination des dirigeants et le choix des administrateurs. Un texte de loi pourra ainsi préciser les conditions dans lesquelles, le haut comité des nominations, chargé d’examiner les profils et projets des postulants, pourra aboutir au candidat retenu.
L’information constitue une donnée capitale permettant à l’Etat une meilleure prise de décision en matière d’accompagnement de l’entreprise dans son plan d’investissement, au travers d’un contrat d’objectifs et de moyens. Ce qui suppose au préalable, que l’entreprise publique soit gérée dans de bonnes conditions, avec responsabilité, équité, efficacité et dans un esprit d’éthique.
Mettre l’information à la portée de tous permet, non seulement à l’Etat et à ses représentants, mais aussi aux citoyens d’être des « sentinelles et des observateurs avertis » sur la gestion du patrimoine public, et d’émettre éventuellement des avis.
Dans un environnement fluctuant, la transparence constitue un élément réducteur d’incertitude et maintient, par conséquent, la confiance tant au niveau des citoyens, de la puissance publique, des partenaires techniques et financiers que du personnel de l’entreprise.
La transparence peut sembler un outil idéologique. Mais elle a le mérite, dans les pays en développement, d’induire des conduites de bonne gouvernance, et par conséquent, de réduire la pauvreté.
Tant qu’elle reste publique, elle ne constitue pas une menace pour la sphère de l’intime. Et il est impérieux d’aller vers cette « normativité » et d’en acquérir le réflexe.
CHRISTOPHE HINKATI
NORMANDIE
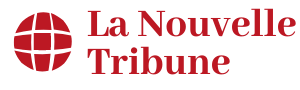
Laisser un commentaire