Qui disait que le mot démission est absent du vocabulaire des Béninois ? On veut, par là, soutenir l’idée selon laquelle, au Bénin, celui qui est à un poste de responsabilité s’y accroche ferme, s’y enracine durablement.
On en conclut vite, qu’au Bénin, on n’aime pas passer la main, qu’au Bénin, on n’aime pas quitter les choses. Au risque de voir les choses vous quitter.
Pourtant, il y a tant et tant de Béninois qui partent, dans les délais réglementaires, au terme d’une mission accomplie. Il y en a d’autres qui mettent leur démission dans la balance. Chaque fois que leur honneur est en jeu. Quand ils ont à défendre une idée. Dans le souci d’illustrer un idéal. On ne saurait dire, de ce point de vue, que le mot démission est inconnu des Béninois. Qu’une poignée d’exceptions ne nous empêche pas de voir la forêt des bons exemples.
Lire également : Séance ordinaire du Bureau directeur de la Cstb : Gaston Azoua sur les traces de Benoît XVI
Une hirondelle, dit-on, ne fait pas le printemps. L’annonce de Gaston Azoua de libérer le Secrétariat général de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin (CSTB) n’inaugurera aucun printemps des démissions dans notre pays. Idem du départ annoncé de la vie publique de Albert Tévoèdjrè, un des dinosaures de la vie politique nationale, actuel Médiateur de le République. Les choses suivront leur cours normal. Mais qu’est-ce qui explique que l’annonce du départ de l’un comme de l’autre prend soudain la dimension d’un événement dont l’onde de choc n’est pas prête de faiblir ?
Nous pouvons nous définir comme la somme de nos habitudes. Napoleon Hill parle de la «force cosmique de l’habitude». Nous finissons, la force de l’habitude aidant, par situer tout acteur majeur de la vie publique, face à tout événement, à une place donnée, dans une posture déterminée.
Quand la scène sociale s’échauffe ou s’enflamme, le commun des Béninois est capable d’anticiper le discours, les faits et gestes de Gaston Azoua. N’incarne-t-il pas, dans les esprits, le syndicaliste radical et bouillant ? Il a la critique acérée, le verbe toujours haut, prêt à croiser le fer avec l’autorité. C’est l’infatigable défenseur du travail et du travailleur, le Robin des bois qui vendange sur les terres d’un syndicalisme pur et dur.
Albert Tévoèdjrè est assimilé, vu et apprécié comme l’homme des formules choc. Ses idées sont faites pour surprendre. Il est toujours de plain-pied avec toutes les situations. Comme s’il tenait à portée de main sinon à portée d’esprit un «truc» original à tous égards, magique à tous les coups. Comme s’il tirait, à tout moment et en toute circonstance, de sa boîte à malice, la poudre miraculeuse qui, sur l’instant, peut tout décanter. Quitte à déchanter plus tard.
Nous sommes désorientés quand des personnages d’une telle envergure bougent de leur position habituelle. Nous sommes ébranlés, parce que nous ne pouvons plus les voir à une place qui les identifiait et à laquelle ils s’identifiaient. Aussi troublent-ils et embrouillent-ils notre regard. Aussi nous obligent-t-ils à une révision, sinon à une adaptation, en rapport avec l’image que nous avons d’eux. En somme, nous ne nous habituons point à l’idée de les perdre de vue ou de devoir nous habituer à accepter le vide qu’ils créent.
Il reste que partir, passer la main, cela relève d’une sagesse profonde inscrite dans la chair même de la nature. Les arbres qui nous entourent, à saison régulière, voient leurs feuilles jaunir et tomber. Les anciennes feuilles laissent ainsi la place à de jeunes pousses. Ceci, dans un cycle de renouvellement continu. Parce que la nature est mouvement et changement. Parce qu’elle est évolution et rénovation.
Le plus grand service à rendre, par les anciens, à une structure, à une entreprise, fût-elle l’œuvre de leurs mains ou de leur vie, c’est de se rendre de moins en moins indispensables, en organisant la relève. «Un vieillard assis, selon un adage de chez nous, voit plus loin qu’un jeune homme debout». Cela est incontestable, l’expérience étant une denrée non négociable sur les places boursières du monde. Mais la sagesse devrait guider le vieillard vers un plus jeune pour qu’il s’asseye à sa place et voie loin, aussi loin que lui-même. C’est à ce seul et unique prix que pourrait se justifier la sage interrogation de Gustave Courbet : «A quoi sert la vie si les enfants n’en font pas plus que leurs pères?
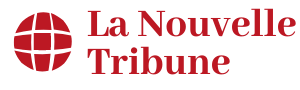
Laisser un commentaire