Etant garant des grands défis du développement, chaque gouvernement se dote de plusieurs politiques, dont celle dite budgétaire, pour atteindre ses objectifs. Toutefois, cette politique, comme toute autre d’ailleurs, n’est pas sans limites. A la veille de l’étude du Budget général de l’Etat béninois, exercice 2014, il s’avère nécessaire de permettre aux « profanes » de comprendre le but de cet exercice annuel du gouvernement, par une explication de la démarche.
Ainsi, faut-il comprendre par « politique budgétaire » un ensemble de mécanismes que met en œuvre un gouvernement, pour impacter l’économie d’un pays. Ceci en jouant sur ses prérogatives dans la fixation des recettes, et les priorités de l’Etat dans la répartition des dépenses publiques. C’est en réalité, un des moyens dont dispose le gouvernement pour réguler l’économie et conduire des actions sur les cycles économiques.
Et dans ce sens, le gouvernement peut, par exemple, compenser un ralentissement de la demande privée, par une augmentation des dépenses publiques, afin d’inciter l’économie, mais avec pour conséquence une dégradation du solde public.
À l’inverse, lorsque la croissance économique est élevée, la discipline budgétaire permet de réduire le déficit public, voire de constituer des excédents qui pourront être utilisés ultérieurement.
La politique budgétaire s’appuie sur plusieurs éléments qui constituent ses leviers. Au nombre de ces principaux leviers, il faut compter les recettes. Elles prennent en compte la fiscalité, les emprunts et les recettes exceptionnelles, qui regroupent, entre autres, le portefeuille d’actifs publics. Nous avons, également, les dépenses publiques. Ici, il s’agit des dépenses réservées à la politique sociale, aux aides aux entreprises, aux investissements en infrastructures publiques, aux aides à la recherche, aux exonérations fiscales, aux salaires des fonctionnaires, à la création des emplois publics, les emplois aidés, etc.
Mais, il existe plusieurs politiques budgétaires dont, entre autres, celle dite discrétionnaire et celle dite volontariste, ou encore celle dite de relance. Chacune de ces politiques a ses limites. Le cas de la politique budgétaire volontariste paraît très flagrant. Et cette politique budgétaire est très critiquée, aujourd’hui, pour ces limites. En effet, les besoins de financement liés à l’accroissement des dépenses publiques, provoquent généralement une hausse des emprunts de l’État, et du fait de cette demande supplémentaire adressée aux marchés de capitaux, des taux d’intérêt. Alors que cette hausse des taux décourage une partie des achats des consommateurs, financés par l’emprunt, et réduit les investissements des entreprises, lorsque leur rentabilité est insuffisante au regard du coût de financement par l’emprunt. Aussi, constate-t-on que l’accumulation des déficits budgétaires vient gonfler l’encours de la Dette publique, et augmente les charges futures de l’État.
Or plus un État est endetté, plus la charge de cette dette est élevée. Celle-ci pèse d’autant plus sur son budget, car un niveau de dette important entraîne des taux d’intérêts élevés lorsque l’État veut contracter de nouveaux emprunts. À terme, le poids de la dette peut ainsi devenir insoutenable par rapport au niveau des recettes de l’État.
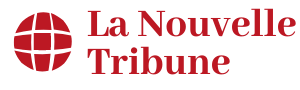
Laisser un commentaire