Le chapitre V intitulé Gouvernance locale :la décentralisation béninoise en panne écrit en 2005 est l’avant dernier de l’ouvrage Bonne gouvernance au Bénin (X). Il précède le chapitre final sur les réformes financières (son second domaine de compétence). La gouvernance locale en panne sonne comme le testament de celui qui a conduit de bout en bout le processus de la décentralisation, d’abord en tant que ministre de l’Intérieur de 1991 à 1993 puis acteur principal des forums initiés pour la rédaction des textes d’application.
Testament aussi de l’élu local(2ème adjoint au maire de Cotonou) qui a vécu les premières années de mise en œuvre du processus. Dans le style clair et limpide qu’on lui connaît Richard Adjaho donne sans détour les deux raisons fondamentales pour lesquelles on pouvait dire en fin 2005 que la décentralisation est mal partie à savoir : le refus de l’Etat central de transférer les compétences et les ressources aux communes et l’incompétence des élus locaux qui préfèrent les jumelages avec les communes des pays du Nord à la recherche des ressources propres à promouvoir le développement local. Aujourd’hui plus de 14 ans après la sortie de l’ouvrage, on ne peut pas dire que la situation des communes a radicalement changé.
La Rédaction
Bon nombre de praticiens ou d’observateurs du deuxième processus de décentralisation, celui qui a démarré au Benin en février 2003, pourraient penser que l’élu local que je suis, fait preuve ici d’un pessimisme non fondé, précoce ou mal venu. Ou alors que l’opinion que j’exprime ici ne serait que la manifestation d’un certain dépit par rapport à un processus dans lequel je me suis investi presque dix ans durant.
Peu sujet à des états d’âme, et heureusement à l’abri des jugements superficiels, je puis assurer qu’il n’en est rien. Sur la base de l’observation stricte des faits et gestes de l’Etat, c’est-à-dire en gros du Gouvernement de notre pays, j’affirme aujourd’hui que la décentralisation béninoise est en panne. Voici pourquoi.
1 – Le privilège et la panne
J’ai un rare privilège qui comporte trois aspects. Le premier est que par la volonté du Président Soglo, j’ai dirigé de 1991 à 1993, pendant 25 mois, un Ministère important et sensible, celui de l’Intérieur et de la sécurité C’est au cours de cette période, notamment aux Etats généraux de jan vier 1993, que sous ma direction, les principales orientations de notre décentralisation ont été arrê tées. C’est entre février et Août 1993 que les projets de lois qui régissent aujourd’hui le fonctionnement de nos communes ont été élaborés par le Comité de suivi des Etats généraux que j’ai créé. Le deuxième privilège que j’ai eu est qu’à mon retour en septembre 1996 de notre ambassade de Paris, en raison du retard considérable pris dans le vote des lois de décentralisation, j’ai eu l’opportunité de travailler de nombreuses années encore et de m’exprimer dans toutes sortes de forums sur la question de la décentralisation et de la gouvernance locale. Enfin, élu conseiller municipal en décembre 2002 et 2° adjoint au Maire de Cotonou en février 2003, je suis dans la pratique quotidienne de la décentralisation depuis deux ans et demi. Toute modestie gardée, je me considère donc comme un observateur de premier plan dans la mise en oeuvre de ce que la Constitution de décembre 1990 a voulu en matière de gouvernance locale pour notre pays.
La décentralisation béninoise est en panne parce que, voulue par la Conférence Nationale formalisée par les Constituants de 1990, elle a été mise en oeuvre presque sous contrainte nationale et extérieure par l’Etat qui aujourd’hui semble la tolérer comme un enfant bâtard, Elle n’est donc pas soutenue par l’Etat qui est pourtant son géniteur, presque malgré lui. La deuxième décentralisation béninoise est en panne parce que les élus locaux, malgré les innombrables ateliers de travail, séminaires, colloques, tables rondes qui ont eu lieu entre 1997 et février 2003, date d’installation des communes, les élus locaux ont été ou se sont peu préparés à la gestion des collectivités locales. Aujourd’hui, un bon nombre de responsables locaux malgré les plans de développement adoptés, maîtrisent mal la gestion de leurs localités et naviguent à vue. Elle est en panne parce qu’un grand nombre de Maires mettent tous leurs espoirs dans des partenariats qui ne peuvent hélas se substituer à l’action de l’Etat béninois. Cette panne est aggravée parce que des considérations, souvent politiciennes, sans rapport avec le dévelop pement local, véritable but de la décentralisation, viennent interférer dans la gestion quotidienne des communes et surtout dans les rapports que l’Etat entretient avec elles.
2 – Les préalables pour une bonne décentralisation
Pour qu’une décentralisation, transfert de compétences et de ressources du niveau national au niveau local soit possible, il faut d’abord qu’elle soit voulue et conduite par l’Etat. En décentralisant, l’Etat obéit à un certain nombre de contraintes politiques qui généralement ont leur origine dans l’histoire politique du pays et qui sont traduites dans la Constitution et dans ses lois. Mais une fois la décen tralisation mise en route par le choix des dirigeants locaux, il est impérieux que les lois soient respec tées. Le respect des dispositions légales signifient notamment le transfert effectif des compétences et des ressources financières et humaines aux communes pour leur permettre de fonctionner.
Depuis février mars 2003, l’Etat béninois s’est comporté envers les communes comme il le faisait avec les anciennes circonscriptions administratives, alors qu’elles ne sont pas de même nature et que les transferts de compétences et de ressources que l’Etat doit opérer à leur profit sont formellement définis par la loi. Les anciennes sous préfectures et circonscriptions urbaines étaient des démembrements de l’Etat, alors que les communes sont des collectivités territoriales distinctes et autonomes.
3 – Quelques exemples
Les lois de décentralisation disposent claire ment que toutes les communes ont la responsabilité de la construction, de l’équipement, des réparations et de l’entretien des écoles maternelles et des écoles primaires. Les communes à statut particulier, à savoir: Cotonou, PortoNovo, Parakou, ont en plus, ces mêmes compétences pour les écoles secondaires et professionnelles. L’Etat béninois n’a donc plus le libre choix en la matière en ce sens que les cartes scolaires, c’est à dire la localisation et la réalisation de ces écoles sont désormais de la responsabilité des communes et que les ressources qui sont logées au budget général de l’Etat doivent être transférées obli gatoirement aux communes. C’est formellement ce que prévoit la loi. Ces ressources, aussi bien d’origine nationale qu’extérieure, crédits, subventions ou
dons, figurent bel et bien dans le budget de l’Etat. Mais à ce jour d’août 2005, pas un franc CFA n’a été transféré depuis mars 2003 aux communes dans ce cadre. Dans tous les cas pas au budget de la ville de Cotonou. Dans la mesure où l’éducation nationale est l’une des plus importantes fonctions publiques assu rée par l’Etat, les ressources en question se chiffrent par dizaines de milliards de francs CFA. Le non transfert aux communes des ressources destinées à la réalisation des infrastructures scolaires est inadmis sible parce qu’il est contraire aux dispositions expli cites des lois de décentralisation. Il en fausse l’esprit et la lettre et laisse à l’Etat, donc au Gouvernement des tâches dont il n’a plus légalement la responsabi lité. La situation est identique pour les domaines de la santé, des sports, de la culture et j’en passe.
La Constitution de 1990, en disposant de la création des collectivités locales a voulu « dégraisser » l’Etat, transférer l’exercice de responsabilités effectives aux élus locaux pour que l’Etat se concentre sur des tâches essentielles. Il n’est, par exemple, plus admissible que l’Etat béninois s’occupe de savoir où il faut construire une école primaire dans le départe ment des Collines OU de la Donga lorsque les élus locaux qui sont des responsables de proximité sont parfaitement capables de le faire et de le faire beau coup mieux. Il est clair à mes yeux que ces transferts réclamés au profit des communes doit se faire avec un maximum de précautions et les règles d’utilisation des ressources publiques rappelées et mises en œuvre . On peut avancer que c’est parce qu’il continue de se comporter ainsi vis-à-vis des collectivités locales que l’Etat ne s’occupe plus convenablement des autres grands domaines que sont la production nationale, les grands équilibres économiques et financiers, la sécurité et la défense, les relations extérieures. Le transfert des compétences ne doit pas être verbal, ni seulement écrit, il doit être réel et effectif.
Globalement, les dispositions des sections 1, 2 et 3 du Chapitre 3 de la loi 97027 portant organisation des communes, dispositions relatives aux compétences des communes sont restées lettres mortes. Ces sections qui concernent respectivement le développement local, les infrastructures, l’équipement et les transports, l’environnement, l’hygiène et la salubrité ne peuvent être correctement mises en œuvre que si les communes bénéficient de la part de l’Etat de l’application effective des dispositions de la section 1 du chapitre 2 de la loi portant Régime financier des communes.
Le transfert des ressources humaines est a l’image de celui des ressources financières. L’Etat qui regorge de cadres oisifs, se refuse d’en transférer une partie aux collectivités locales afin que celles ci fonctionnent mieux. II y a de nombreux domaines prévus dans les lois que nos communes en l’état actuel de leur personnel sont incapables de prendre en charge et d’assumer. Le transport et la circulation dans une ville comme Cotonou ou des dizaines de
milliers de véhicules circulent chaque jour en est un exemple. La prise en charge d’un tel secteur nécessite la présence au sein de l’équipe municipale de plusieurs ingénieurs, techniciens et économistes des transports, capables de penser un système efficace et de le mettre en œuvre.
4- Pourquoi cela ?
La situation décrite plus haut, caractérisée par la non application des lois de décentralisation et la banalisation des communes a, à mes yeux, plusieurs causes. La première est le manque de vision de l’Etat béninois, c’est-à-dire du Gouvernement qui ne par vient toujours pas à se convaincre que le bon fonctionnement des collectivités locales est un facteur d’un meilleur fonctionnement du pays. Cette situation a été rendue possible aussi parce que en dehors de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi de l’Etat, il y a eu la naïveté des nombreux responsables de communes qui ont cru qu’il suffisait que la loi prévoie quelque chose pour qu’elle se fasse. Ce faisant, ils ont oublié qu’en règle générale , un transfert de pouvoir n’est jamais aussi automatique et oublie aussi que l’organisation même des élections locales a été un long bras de fer entre le Gouvernement, la société civile, un certain nombre de pays développés et les institutions financières internationales. L’épisode de la mise en place de l’Association des communes du Bénin en est une grande illustration. Au lieu de s’entendre d’abord en leur sein pour mettre en place une association des communes forte et crédible, véritable partenaire du Gouvernement et puissant groupe de pression, nombre d’élus locaux se sont ingéniés sous l’influence du Gouvernement, a affaiblir l’organisation dès sa naissance. Nous en payons le prix présentement. Un grand nombre de Maires crient aujourd’hui leur désarroi.
5 Et maintenant
Dans la mesure ou manifestement aujourd’hui, malgré les élections locales de décembre 2002, c’est l’option de la poursuite de la centralisation du fonctionnement de l’Etat qui a pris le dessus, je suis très sceptique qu’un débat avec le Gouvernement conduise a un changement notable d’attitude vis-à-vis des communes. S’agissant de Cotonou par exemple, les discussions entre l’Etat et les autorités municipales sur le transfert du marché Dantokpa ont été jusqu’à la limite de la compromission. Et pourtant. Si l’Etat béninois continue d’avoir la même vision de la décentralisation et le même comportement vis-à-vis des collectivités locales, ces dernières vont s’épuiser dans des actions mineures, de faible portée économique et sociale. Le salut des communes béninoises et l’approfondissement de notre décentralisation passe à mes yeux par un changement de vision du Pouvoir central, à vrai dire par l’avènement d’un nouveau Pouvoir. II faut donc espé rer que l’ équipe qui va prendre la direction de notre pays en avril 2006 soit dans ces dispositions. Si ce changement de vision n’a pas lieu a cette occasion la, si de nouvelles relations ne s’instaurent pas entre les communes et l’Etat, les responsables de nos communes vont s’épuiser dans les opérations de jumelage avec les collectivités locales des pays développés sans grands résultats. Car les maigres ressources et les petits avantages que nos communes tireront des jumelages ou de la coopération décentralisée ne remplaceront jamais le transfert réel de ressources de l’Etat béninois à leur profit.
(X) Bonne gouvernance au Bénin: ma contribution, Éditions du Flamboyant, 2005, 148 pages
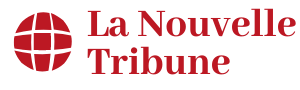

Laisser un commentaire